Introduction
Depuis 50 ans, le Mouvement de Lausanne a joué un rôle central, influencé des changements dans les programmes missionnaires et catalysé de nouvelles orientations pour l’évangélisation mondiale. Document accompagnant le rapport État du Mandat missionnaire,1 et publié à l’occasion du Quatrième congrès de Lausanne qui s’est tenu à Séoul-Incheon en 2024, la Proclamation de Séoul (PS)2 cherche une réponse aux lacunes contemporaines mises en évidence par le travail théologique du Mouvement, à travers une réflexion jugée nécessaire pour identifier les lacunes constatées dans la mission mondiale actuelle et proposer des pistes en vue de renforcer et affûter l’action de la mission).3
La Déclaration de Lausanne (DL),4 issue du Premier congrès de Lausanne en 1974, est un document historique qui a inspiré les évangéliques dans leur tâche commune d’évangélisation du monde. Ce congrès donna lieu à des consultations thématiques de fond portant sur des questions telles que le caractère singulier du Christ, l’Évangile et la culture, l’évangélisation et la responsabilité sociale. Le Manifeste de Manille,5 issu du Deuxième congrès de Lausanne, en 1989, s’appuie sur les fondements de la DL et appelle l’Église tout entière à apporter l’Évangile tout entier au monde tout entier. Le Troisième congrès de Lausanne (2010), qui s’est tenu au Cap, en Afrique du Sud, déboucha sur l’Engagement du Cap.6 Sa contribution a été de recadrer la mission comme une invitation privilégiée à travers une herméneutique missiologique de la Bible comme histoire complète de l’action de Dieu dans le monde. Plutôt que de faire du Mandat missionnaire le motif central de la mission, l’Engagement affirme que « la mission de Dieu découle de l’amour de Dieu. »(CTC I-1)
La Proclamation de Séoul continue de s’appuyer sur les convictions théologiques centrales du Mouvement de Lausanne concernant « la centralité de l’Évangile (Section I) et une lecture fidèle de l’Écriture (Section II) » afin de « relever les défis auxquels l’Église mondiale est aujourd’hui confrontée (Sections III-VII), et persévérer dans une aspiration à témoigner fidèlement de notre Seigneur crucifié et ressuscité – de partout, à partout ».(Préambule de la Proclamation de Séoul).
Dans les limites de l’espace disponible pour cet article, nous avons choisi d’aborder quelques thèmes de la PS et réfléchirons à comment celle-ci contribue à clarifier certaines convictions théologiques autour de la mission. L’article proposera ensuite quelques réponses missiologiques que les suites du congrès pourraient susciter dans toutes les sphères de la société. Quels peuvent être les résultats significatifs d’un tel rassemblement mondial de chrétiens pour la revitalisation de notre regard sur le monde en vue d’y avoir le plus grand impact pour le Christ ? Comment pouvons-nous nous appuyer sur les riches ressources théologiques du Mouvement de Lausanne pour catalyser de nouveaux mouvements missionnaires de partout vers partout ?7
L’Évangile : l’histoire que nous vivons et racontons
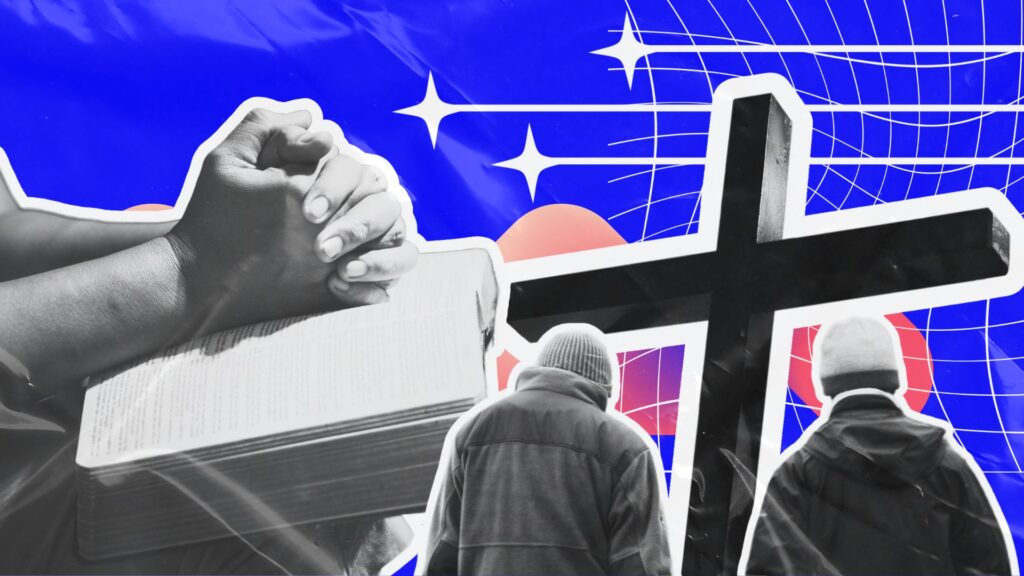
Les sept thèmes identifiés dans la Proclamation de Séoul cherchent à produire un sentiment de clarté dans un monde de confusion, tant sur le plan de la théologie que de la mission : nos convictions chrétiennes sont enracinées dans la Bible et dans deux millénaires de tradition chrétienne.
À partir de ces fondements, la mission de l’Église est de faire des disciples du Christ, « proclamer et rendre visible le Christ – ensemble… notre présence au monde, remplie du Christ, notre proclamation, centrée sur le Christ, et notre pratique, conforme au Christ ».8
La Proclamation de Séoul souligne l’importance de la formation des disciples, essentielle à la mission. Par exemple, elle met en évidence les problèmes liés à l’évangile de la prospérité, aux défaillances morales parmi les dirigeants d’Église ou à la problématique des pratiques homosexuelles comme autant d’obstacles au témoignage de l’Évangile. « La poursuite de la justice dans notre vie personnelle, notre foyer, notre Église et les cercles dans lesquels nous vivons ne peut pas plus être séparée de l’annonce de l’Évangile que le fait d’être un disciple ne peut l’être de faire des disciples. » (PS V-73). Plutôt que de lire l’Écriture comme une vérité et de l’appliquer ensuite à l’action missionnaire, de nombreux théologiens du Sud sont enclins à interpréter la vérité dans l’action des expériences vécues pour mettre en évidence le Christ. Par rapport aux documents précédents de Lausanne, la PS consacre, par exemple, un développement important à ce qu’est l’être humain, homme et femme, créé à l’image de Dieu, « une unité physique et spirituelle, ces deux dimensions se complétant mutuellement. » (PS IV-49). Elle souligne que la dignité de la personne a des implications sur la sexualité et le mariage hétérosexuel. Du point de vue des pays du Sud, ces questions sont considérées comme des questions fondamentales de discipulat qui limitent la collaboration. Comment résoudre ces conflits lorsque nous rencontrons d’autres évangéliques, en particulier ceux qui, en Occident, interprètent l’Écriture différemment ?
La contribution distincte du Mouvement de Lausanne pourrait être d’amener divers groupes de responsables à « lire la Bible fidèlement avec la communion des saints de tous les temps et de tous les lieux » (PS II), mais de le faire dans l’optique d’interagir avec ceux qui ne font pas partie de l’Église.9 À cet égard, l’Engagement du Cap encadre la mission biblique par l’ensemble du récit de l’action de Dieu dans le monde qui est sous-tendue par le thème de l’amour. En tant que mouvement missionnaire, plutôt qu’un accord sur les doctrines (qui sont importantes), la plate-forme principale de Lausanne (à la différence des rassemblements ecclésiastiques) est une vision commune de l’Évangile mis à la portée de chacun ; des Églises qui font des disciples, accessibles à tous les peuples en tout lieu ; des leaders à l’image du Christ dans chaque Église et dans chaque secteur ; et un impact du Royaume dans chaque sphère de notre société. Cette collaboration ne signifie pas que les partenaires ne peuvent pas s’interpeller mutuellement chaque fois qu’ils sont confrontés à des scandales liés au pouvoir, à l’argent et à la sainteté dans l’Église du monde occidental et du monde non occidental.
Évangélisation et action sociale

Bien que la Proclamation de Séoul affirme que la mission de l’Église est de déclarer et de mettre en évidence l’Évangile, le congrès n’a pas été en mesure de se démarquer de cinq décennies du Mouvement de Lausanne, faites de débats intra-évangéliques sur la question de savoir si l’évangélisation est centrale et prioritaire ou un partenaire à égalité avec la justice, le dialogue et l’action sociale. L’Engagement du Cap précise que nous sommes appelés à une mission intégrale et que la mission du peuple de Dieu découle de notre amour pour Dieu et pour tout ce qu’il aime. « L’évangélisation mondiale est le débordement de l’amour de Dieu pour nous et par nous. Nous affirmons la primauté de la grâce de Dieu et nous répondons par conséquent à cette grâce par la foi mise en évidence par l’obéissance de l’amour. » (CTC I-1). La question reste donc en suspens pour de nombreuses personnes qui auraient souhaité une position plus tranchée.
Cependant, l’organisation du Quatrième congrès autour de tables rondes, a permis à une diversité de voix (de diverses générations, zones géographiques et genres) de s’exprimer sur des questions critiques, sans qu’aucune position dominante ne soit présentée. En fin de compte, la mission de Dieu exige que le premier et plus grand commandement soit intégré au Mandat missionnaire (Matthieu 22.37-40). L’ecclésiologie et l’interprétation de l’Écriture ont été, à juste titre, au centre des préoccupations des participants au congrès. Vis-à-vis de la mission, la difficulté pour les évangéliques est de savoir comment accorder aux crises qui secouent notre monde une même priorité que celle accordée à l’annonce de l’Évangile ? Où est le cœur de Dieu pour la mission quand on cherche à recentrer les priorités du royaume de Dieu en fonction des grands problèmes mondiaux d’aujourd’hui ? Comment lire l’Écriture à la lumière du manifeste de Jésus pour son royaume sur terre (Luc 4 ; Matthieu 6.33) ?
Après le Congrès, quel impact pour le Royaume dans toutes les sphères de la société ?

Notre monde est confronté à plusieurs crises. La première est d’ordre planétaire : la création gémit en raison de la destruction écologique dévastatrice de l’environnement. Deuxièmement, nous sommes confrontés à une crise de la pauvreté, où le pouvoir et la richesse n’ont pas accru le shalom (la plénitude de vie) des personnes les plus pauvres et marginalisés. Troisièmement, nous sommes confrontés à une crise de la paix, car au sein des clivages politiques et idéologiques, les dirigeants politiques n’ont pas réussi à trouver de solution aux guerres, aux divisions ethniques et au racisme qui ne cessent de croître. En fin de compte,
les congrès mondiaux seront confrontés à une crise d’intégrité si nos réunions ne répondent pas aux problèmes les plus urgents auxquels sont confrontées la majorité des communautés pauvres et les moins évangélisées du monde.
La dimension eschatologique de la mission ne consiste pas tant à offrir aux chrétiens un plan d’évacuation vers le ciel qu’à rechercher pour les pauvres du monde et pour la planète un plan de transformation sur terre. La mission est donc, par la puissance de l’Esprit de Christ, une participation privilégiée à la guérison et à la renaissance de la création tout entière jusqu’à ce que le Christ revienne.
Les conflits de la famille des nations comme obstacle à la proclamation missionnelle ?
La Proclamation de Séoul affirme : « La réconciliation de tous les peuples dans le Christ, vécue dans une relation marquée par la bénédiction mutuelle, est au centre des desseins de Dieu à travers l’Évangile. » (PS VI-77) Par exemple, dans le conflit actuel au Moyen-Orient, « les responsables chrétiens doivent travailler à corriger les erreurs théologiques qui justifient idéologiquement la violence injuste contre des civils innocents ou qui cherchent à légitimer les violations du droit humanitaire international. » (PS VI-84) L’Église ne parvient pas à être une voix prophétique lorsqu’elle reste silencieuse face aux souffrances indicibles dues à une violence injuste.
Plus de deux cents ans d’activités missionnaires protestantes n’ont pas entraîné de mouvements majeurs vers le Christ parmi les adeptes de religions mondiales telles que l’islam, le bouddhisme et l’hindouisme.10 Les déclarations évangéliques continuent de considérer les autres comme des objets de mission plutôt que comme des sujets et des collaborateurs de la transformation apportée par l’Évangile. Il n’y aura pas de paix entre les tribus et les nations tant que l’Église n’aura pas appris à vivre en paix avec des personnes de traditions religieuses différentes. Pour faire preuve d’une authentique réceptivité à l’Évangile, notre théologie de la mission devra dépasser le concept territorial du « nous contre eux ». Par crainte du syncrétisme, les chrétiens n’ont pas encore exploré la contextualisation de ces aspirations religieuses, qui aboutirait à une transformation mutuelle par le biais de rencontres interconfessionnelles.11
Dans la perspective d’aller au-delà de la contextualisation entre les cultures et d’entamer des rencontres sérieuses entre les tenants de différentes religions, le domaine le plus faible de l’initiative de la PS est probablement l’absence d’une partie portant sur la théologie de la religion en rapport avec les stratégies futures de la mission.
Malgré les différences significatives entre les religions et sans compromettre le caractère singulier du Christ, les chrétiens ne devraient pas considérer la majorité des musulmans, des hindous et des bouddhistes comme des ennemis ou des persécuteurs des chrétiens. Sinon, du point de vue des non-chrétiens, la mission chrétienne continuera à être perçue comme une volonté de les traiter comme de simples objets que la mission se charge de changer.
Sans une amitié profonde entre des religions vivantes, notre Église reste théologiquement tribale dans son incapacité à accueillir et à recevoir de la part des musulmans, hindous et bouddhistes les dons d’appartenance à une identité commune.12
Une autre omission concerne l’annonce de la PS au début du congrès. Contrairement aux congrès précédents, aucune séance n’avait été prévue pour permettre aux délégués d’interagir et de donner leur avis sur les thèmes importants dans la PS qui avaient été mis en relief par le groupe de travail sur la théologie. Une occasion manquée !
Remodeler la collaboration dans un monde polycentrique
L’avenir de la mission chrétienne dépend de la qualité des missions provenant d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Cela ne signifie pas que le Nord planétaire n’aura aucun rôle significatif. De nombreuses organisations et alliances missionnaires occidentales reconnaissent la nécessité de modifier les cultures et les structures de leurs appareils dirigeants, en transférant le pouvoir de l’Occident vers le reste du monde.13 Toutefois, les mouvements missionnaires du Sud ne produiront pas d’impact profond ni de transformation durable si ces nouveaux centres perpétuent des paradigmes missionnaires coloniaux sans humilité, sans intégrité et sans modèles de direction marqués par un esprit de service. De nombreux responsables de missions du Sud sont méfiants lorsque les appels à la collaboration deviennent un nouveau moyen de contrôle quand les plates-formes d’influence et les pouvoirs de décision restent entre les mains de ceux qui fournissent le soutien financier. Ils s’interrogent à juste titre : Quelle collaboration et quelles priorités orienteront l’avenir de la mission dans un monde polycentrique ?
Notes
- ‘State of the Great Commission Report,’ Lausanne Movement, accessed January 12, 2025, https://lausanne.org/fr/report.
- ‘The Seoul Statement,’ Lausanne Movement, accessed January 12, 2025, https://lausanne.org/fr/statement/proclamation-de-seoul.
- The Seoul Statement focuses on theology while the State of the Great Commission focuses on areas needing greater strategic collaborative action. It complements and builds on the Lausanne Covenant (1974), the Manila Manifesto (1989), and the Cape Town Commitment (2010).
- ‘The Lausanne Covenant,’ Lausanne Movement, accessed January 12, 2025, https://lausanne.org/fr/statement/la-declaration-de-lausanne.
- ‘The Manila Manifesto,’ Lausanne Movement, accessed January 12, 2025, https://lausanne.org/fr/statement/manifeste-de-manille.
- ‘The Cape Town Commitment,’ Lausanne Movement, accessed January 12, 2025, https://lausanne.org/fr/statement/engagement-du-cap.
- Theological documents of Lausanne are often assessed in terms of how they might move or impact mission thinking and practices. See Robert Schreiter, ‘From Lausanne Covenant to the Cape Town Commitment: A Theological Assessment, ’International Bulletin of Mission Research 35, no. 2 (April 2011): 88-91.
- See ‘The Seoul Statement,’ Section I-16.
- Though a focus on ecclesiology is important, I am in agreement that the overall treatment on the wider scope of mission is weak for ‘the missional church movement puts more emphasis on God’s mission having a church than on God’s church having a mission.’ See Rolf Kjøde, ‘Participant Perspective: Building on a firm foundation,’ Vista, December 14, 2024, https://vistajournal.online/latest-articles/ij1bn5hp85097yjohjeesh6k3rchkm.
- See Terry Muck and Frances Adeney, Christianity Encountering with World Religion (Encountering Mission): The Practice of Mission in the Twenty-first Century, (Michigan: Baker Academic, 2009).
- Evangelicals have proposed fresh ways to engage with adherents of religions within a trinitarian theological framework in order to move evangelicals beyond our parochial boundaries. They challenge our understanding of cultures and religions and propose deeper engagement with respect for the religious other, engage in mutual dialogue and deepen relationships. See Gerald McDermott and Harold Netland, A Trinitarian Theology of Religions: An Evangelical Proposal (Oxford: Oxford University Press, 2014).
- Kang-San Tan, ‘Crossing Religious and Cultural Frontiers: Rethinking Mission as Inreligionisation,’ IJFM 39:2-4, Summer-Winter 2022:69-75, IJFM_39_2_4-Tan-Crossing-Frontiers-and-Response.pdf.
- Although SS did not specifically discuss polycentric mission, the concept permeates the Congress in multiple ways including a working group dedicated to it.

